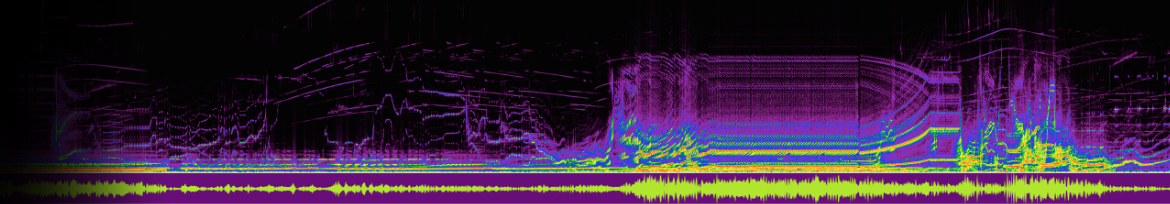English
English Français
Français
Nine AGNERAY-FOFANA

Doctorante contractuelle au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) depuis le 10 octobre 2022.
Équipe "Diversité et évolution culturelles" (DivEC) / UMR 7206 Éco-Anthropologie, Musée de l'Homme.
Recherche :
Thèse en cours | dir. Susanne Fürniss, co-dir. Jérôme Cler
« La construction du savoir sur les instruments de musique africains à partir de l’iconographie musicale dans les écrits européens du XVIe au XXe siècle »
Qu’est-ce que les images anciennes d’instruments et de musiciens dans leur contexte permettent de dire des savoir-faire, des pratiques anciennes et de leur évolution ?
Dans la présente thèse, la construction du savoir sur la musique est questionnée avec la prise en compte de la génétique des témoignages écrits et oraux. Certaines sources ont influé sur d’autres d’un point de vue textuel et visuel, entraînant des recompositions d’images, leur modification et la réinterprétation de leur contenu. Ce phénomène est très présent dans les sources antérieures au XIXe siècle, qui a vu un essor des voyages et donc de l’observation de première main. Certaines illustrations des récits les plus anciens ont été utilisées dans des traités musicaux occidentaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Ceux-ci font parfois apparaître des contresens organologiques dûs à la compréhension erronée des pratiques musicales initialement observées. Il s'agit ici d'apporter une nouvelle réflexion sur ces écrits qui ont longtemps déterminé la compréhension des musiques africaines en Europe.
Publications :
Nine Agneray-Fofana. La construction du savoir sur les instruments de musique africains à partir de l'iconographie musicale dans les écrits européens du XVIe au XXe siècle. 3ème séminaire général du Collegium Musicæ (Sorbonne Université), Nov 2022, Paris, France., 2023. ⟨halshs-03990438⟩
Valorisation:
- 3ème séminaire général du Collegium Musicæ de l’Alliance Sorbonne Université, [14 novembre
2022, Faculté des Sciences et Ingénieries de Sorbonne Université, Paris].
- Journées d’études « Echos, sound ecosystems in travelogues », [25-26 mai 2023, Università degli
studi di Padova, Padoue].
- Séminaire doctoral en ethnomusicologie Arom-Fürniss, [23 juin 2023, Musée de l’Homme, Paris].
- 47ème colloque international de l’ICTMD (International Council for Traditions of Music and Dance), [13-19 juillet
2023, University of Ghana, Legon].
Cursus Universitaire et Diplômes:
[En cours depuis 2022] - Doctorat de recherche en Ethnomusicologie, ED 227, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ;
[2022] - Master de recherche en Musique et musicologie, Université de Lille ;
[2020] - Licence en Musique et musicologie, Université de Lille.
Tutelles
Nous contacter
Institut de recherche en Musicologie (UMR 8223)
Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac
75706 PARIS CEDEX 13
Secrétariat : +33(0) 1 53 79 37 10
par courriel
Sorbonne Université
Centre Univ. Clignancourt
salle 524 (informatique), bureau 531 (direction)
2, rue Francis de Croisset 75018 PARIS
Tél : +33 1 53 09 56 00
Centre Sorbonne
Salle Pirro
1, rue Victor Cousin 75005 PARIS
Tél : +33 1 40 46 22 11
Maison de la recherche
Salle 312 et 313
28, rue Serpente 75006 PARIS
Tél : +33 1 53 10 57 00